Partager
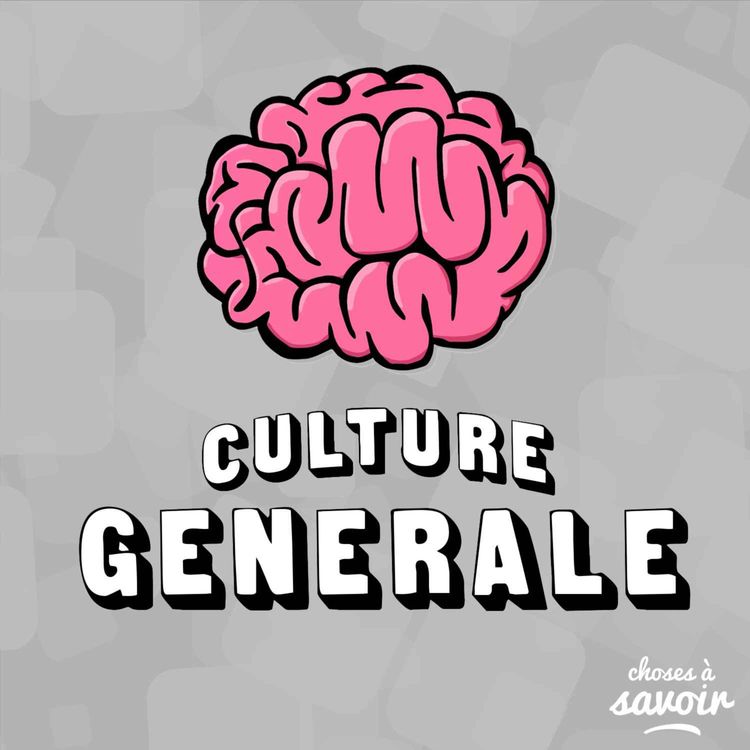
Choses à Savoir - Culture générale
A-t-on le droit de garder de l'argent trouvé dans la rue ?
Il vous est peut-être déjà arrivé de trouver de l'argent dans la rue. Certains peuvent alors penser que, en l'absence de tout document prouvant l'identité du propriétaire de l'argent, on peut le garder pour soi.
Or il n'en est rien. En effet, le Code civil précise que la personne ayant perdu une chose, des billets de banque par exemple, peut, durant trois ans, réclamer la restitution de cette chose auprès de la personne qui l'a trouvée.
Donc, il est clair que l'argent trouvé dans la rue n'appartient pas à celui qui le trouve.
Le mieux est alors de rapporter cet argent au commissariat ou à la gendarmerie les plus proches, où on le mettra en sûreté dans un coffre. Il est préférable de faire cette démarche assez rapidement, pour démontrer votre honnêteté. De fait, la loi stipule que l'argent doit être rapporté dans les 24 heures suivant sa découverte.
En principe, la somme sera ensuite transférée vers la Caisse des Dépôts et Consignations. Dans le même temps, une enquête sera entreprise, dans le but de retrouver le propriétaire de cet argent perdu.
Mais tout cela ne veut pas dire pour autant que vous n'avez aucun droit sur l'argent trouvé. En effet, si la somme en question n'a pas été réclamée durant un an, la personne qui l'a trouvée en est déclarée usufruitière.
Ce qui veut dire qu'elle est mise en possession de l'argent, mais qu'elle n'a pas le droit de le dépenser durant deux ans. En effet, le propriétaire peut toujours le lui réclamer durant cette période.
Les contrevenants s'exposent à une sanction pénale, qui peut aller jusqu'à un an d'emprisonnement et au paiement d'une amende d'un montant maximum de 1.500 euros. En outre, ils doivent rendre l'argent trouvé.
Si la police n'est pas convaincue par les déclarations de la personne qui a trouvé l'argent, elle peut l'interroger, et même diligenter une enquête, afin d'en apprendre davantage sur les circonstances de cette découverte.
More episodes
View all episodes

Quel est le plus ancien drapeau au monde ?
01:50|Le plus ancien drapeau d’État au monde encore utilisé est très largement considéré comme étant celui du Danemark : le Dannebrog.Le plus vieux drapeau “encore en service”La tradition danoise fixe sa naissance au 15 juin 1219, lors de la bataille de Lyndanisse (dans l’actuelle Estonie). La légende raconte qu’au moment où l’armée danoise était en difficulté, un étendard rouge frappé d’une croix blanche serait tombé du ciel. Le signe aurait galvanisé les combattants, qui auraient remporté la bataille. C’est ainsi que serait né le Dannebrog, littéralement « l’étoffe danoise ».Bien sûr, les historiens rappellent que cette histoire est une légende nationale : les premières attestations vraiment solides du drapeau apparaissent plus tard, au Moyen Âge, et le motif pourrait être dérivé des bannières chrétiennes utilisées durant les croisades (croix blanche sur fond rouge, symbole guerrier et religieux fréquent à cette époque). Mais le point essentiel reste vrai : le Dannebrog est le plus ancien drapeau national en usage continu. Un modèle pour tous les drapeaux nordiquesAutre aspect passionnant : ce drapeau est aussi l’ancêtre direct d’une famille entière de drapeaux. Sa croix décalée, appelée “croix scandinave” ou “croix nordique”, a inspiré :la Suèdela Norvègela Finlandel’Islandeles îles Féroé, etc.En réalité, le Dannebrog n’est pas juste un vieux symbole : c’est un prototype devenu matrice identitaire d’une région entière.Pourquoi lui, et pas un autre ?Parce qu’un drapeau n’est considéré “le plus ancien” que s’il remplit une condition très stricte : être encore utilisé officiellement aujourd’hui sans interruption, par un État souverain.D’autres drapeaux sont très anciens (Pays-Bas, Écosse, etc.), mais le cas danois est unique : on retrouve le même design, la même idée, la même continuité, sur plus de huit siècles.
Pourquoi le nombre de jours dans un mois est né d'une supersitition ?
02:49|Pour comprendre, il faut remonter à la Rome antique. Les Romains ne voyaient pas les nombres comme nous. Pour eux, les nombres avaient une valeur symbolique : certains étaient jugés favorables, d’autres inquiétants. Et dans leur imaginaire, les nombres pairs étaient souvent associés au mauvais sort, à l’incomplétude, voire à la mort. À l’inverse, les nombres impairs étaient réputés plus “chanceux”, plus harmonieux. Une superstition qui a eu des conséquences très concrètes sur… notre calendrier.Au début, le calendrier romain était très différent du nôtre. Il a connu plusieurs versions, mais un tournant important arrive vers le VIIe siècle avant notre ère, sous le règne du roi Numa Pompilius, à qui l’on attribue une grande réforme. L’année romaine devait fonctionner avec des mois proches du cycle lunaire : environ 29,5 jours. Résultat : des mois de 29 jours ou de 31 jours, pour rester dans l’impair. Mais problème : additionnés, ces mois donnaient une année de 354 jours, donc un total pair… ce qui était très mal vu.Que faire ? Dans cette logique superstitieuse, la solution fut simple et presque absurde : pour rendre l’année “plus acceptable”, on joua sur un mois en particulier. Février, déjà associé à des rites de purification et au monde des morts, fut rendu plus court. On lui retira un jour afin d’obtenir un total annuel impair. Février devint donc le mois “sacrifié”, celui qu’on raccourcit, et qui gardera longtemps cette réputation de mois à part.Mais évidemment, un calendrier fondé sur la lune ne colle pas parfaitement avec les saisons. Une année solaire fait environ 365 jours et un quart. Les Romains ont donc dû ajuster régulièrement leur calendrier, parfois en ajoutant un mois entier, parfois en bricolant les durées. Cela a créé du désordre… jusqu’à la grande réforme de Jules César en 46 avant J.-C., avec le calendrier julien, qui fixe enfin un système stable : une année de 365 jours, avec un jour ajouté tous les quatre ans.Au final, notre répartition actuelle des jours n’est pas “logique” : elle est historique. Si l’on repartait de zéro, on pourrait imaginer des mois beaucoup plus réguliers. Mais nos 30, 31 et notre février bancal sont les cicatrices d’un vieux mélange de superstition romaine, de cycle lunaire et de compromis politiques. Une preuve que même le temps, parfois… se construit sur des croyances.
Pourquoi y a-t-il si peu de noms de famille en Chine ?
02:47|En Chine, on estime qu’il existe aujourd’hui environ 4 000 noms de famille différents réellement en usage.Selon les sources et la façon de compter (variantes d’écriture, noms minoritaires, noms composés à deux caractères), on trouve des estimations allant d’environ 3 100 patronymes courants jusqu’à 6 000+ au total. Historiquement, la Chine a pourtant connu près de 12 000 noms recensés dans les textes anciens, mais une grande partie a disparu ou s’est fondue dans d’autres.En France, c’est l’inverse : la diversité est immense. On parle généralement de 1,2 à 1,5 million de noms de famille distincts si l’on compte toutes les graphies et variantes (ex : Dupont/Dupond, ou les noms avec/sans accents), et de plusieurs centaines de milliers de noms réellement portés de façon significative.En Chine, c'est un phénomène très frappant, mais il s’explique assez bien.1) Les noms chinois se sont fixés très tôtEn Chine, le nom de famille (姓) existe depuis l’Antiquité et structure la société en clans et lignages. Le système est donc ancien, stable et très codifié.En Europe, au contraire, les noms se sont fixés tard : beaucoup de gens n’avaient pas de patronyme héréditaire avant le Moyen Âge ou même l’époque moderne. Résultat : plus de diversité.2) Beaucoup de noms ont été “absorbés”Au fil des siècles, lors de guerres, migrations ou changements de dynastie, des familles ont souvent abandonné un nom rare pour adopter un nom plus commun ou prestigieux (par protection, par intégration sociale, ou pour se fondre dans la population).Cela a “compressé” la diversité des patronymes.3) Standardisation administrativeL’État impérial chinois a été très tôt un État bureaucratique : recensements, registres, examens… Les noms ont été normalisés, et les variantes locales ont souvent été uniformisées. Ce qui est rare, mal enregistré ou trop complexe finit par disparaître.4) Des noms très courts, donc moins de possibilitésLa plupart des noms chinois sont à un seul caractère : Wang, Li, Zhang…Les noms à deux caractères existent, mais sont minoritaires. Moins de combinaisons = plus de concentration.
Pourquoi la France a-t-elle attaqué Taiwan ?
02:35|Quand on pense à Taïwan, on imagine plutôt les tensions entre Pékin et Taipei, les semi-conducteurs, ou la mer de Chine… certainement pas la France. Et pourtant : sur l’île, à Keelung, un cimetière militaire français abrite les dépouilles de plus de 700 officiers, sous-officiers et soldats morts “au champ d’honneur”. Pourquoi des soldats français sont-ils tombés si loin de l’Europe ? La réponse nous ramène à une guerre oubliée : la guerre franco-chinoise de 1884-1885.À cette époque, la France est engagée dans une expansion coloniale en Asie du Sud-Est. Son objectif principal : prendre le contrôle du Tonkin, au nord du Vietnam actuel, et consolider ce qui deviendra bientôt l’Indochine française. Problème : la Chine considère historiquement le Vietnam comme une zone d’influence et soutient des forces locales hostiles à la présence française. Résultat : les tensions montent… jusqu’au conflit ouvert.La guerre éclate en 1884. La France se bat sur plusieurs fronts : au Tonkin, bien sûr, mais aussi sur mer. Et c’est là que Taïwan entre en scène. À l’époque, l’île appartient à l’empire chinois des Qing. Taïwan est stratégique : elle contrôle une partie des routes maritimes et sert de base logistique pour ravitailler les troupes chinoises et harceler les positions françaises au Vietnam. Pour Paris, frapper Taïwan, c’est donc frapper le nerf de la guerre.En 1884, la Marine française attaque Keelung, dans le nord de l’île. Les combats sont rudes, mais l’ennemi le plus meurtrier n’est pas toujours celui qu’on croit. Car dans ces expéditions, les soldats français affrontent aussi un adversaire invisible : le climat, les moustiques, la dysenterie, le paludisme, le choléra. Les pertes sanitaires dépassent souvent les pertes au combat. Beaucoup d’hommes meurent non pas d’une balle, mais d’une fièvre.L’armée française occupe certaines positions, tente d’étouffer l’approvisionnement chinois, et impose un blocus maritime. Mais cette campagne de Taïwan ne se transforme pas en conquête : elle sert surtout de pression militaire et diplomatique dans un conflit plus large.La guerre franco-chinoise se termine en 1885. La Chine renonce à sa tutelle sur le Vietnam, ce qui ouvre la voie à la domination française en Indochine. Le cimetière de Keelung, lui, reste comme le témoin discret d’un épisode presque effacé de notre mémoire : quand, pour contrôler le Vietnam, la France a aussi porté la guerre jusqu’à Taïwan.
Pourquoi avons-nous l’impression que l’horoscope parle de nous ?
02:26|Avez-vous déjà lu une phrase du type : « Vous êtes une personne sensible, mais vous savez garder le contrôle. Vous avez de grandes qualités, même si vous doutez parfois de vous. » Et vous vous êtes dit : “C’est fou… c’est tellement moi.”Si oui, félicitations : vous venez d’expérimenter l’effet Barnum.L’effet Barnum, aussi appelé effet Forer, est un biais psychologique très puissant : nous avons tendance à croire qu’un portrait général, vague et flatteur nous décrit parfaitement, alors qu’il pourrait convenir à presque n’importe qui. C’est le mécanisme secret derrière de nombreux horoscopes, tests de personnalité “miracles”, voyances, lectures d’aura, ou encore certains contenus viraux sur les réseaux sociaux.Le nom vient de P. T. Barnum, célèbre entrepreneur de spectacles américain du XIXe siècle, à qui l’on attribue l’idée qu’il existe “quelque chose pour tout le monde”. En clair : si une affirmation est suffisamment large, chacun peut s’y reconnaître.Mais pourquoi cela fonctionne-t-il aussi bien ?D’abord parce que notre cerveau adore les histoires cohérentes. Quand on lit une description, on sélectionne instinctivement ce qui colle avec nous. On pense à deux ou trois souvenirs, deux ou trois émotions… et notre esprit complète le reste. Ensuite, ces descriptions sont souvent formulées de manière très habile : elles combinent des traits opposés (“vous êtes sociable, mais vous aimez être seul”), ce qui augmente les chances de viser juste. Elles restent positives, ou au minimum valorisantes, donc on a envie d’y croire.Le psychologue Bertram Forer a démontré cela en 1948 avec une expérience devenue célèbre : il a donné à ses étudiants un “test de personnalité”, puis leur a remis à chacun un profil soi-disant personnel. En réalité, tout le monde avait exactement le même texte. Pourtant, la majorité a jugé la description très précise.L’effet Barnum est dangereux quand on l’ignore, car il facilite la manipulation : un discours vague peut sembler profond, un diagnostic approximatif peut paraître scientifique, et un conseil bidon peut prendre l’apparence d’une vérité intime.En résumé : l’effet Barnum, c’est ce moment où votre cerveau transforme une généralité en miroir… et vous persuade que le texte a été écrit pour vous seul.
Pourquoi dit-on “passer un savon” ?
01:42|“Passer un savon”, c’est réprimander quelqu’un violemment, lui faire une leçon bien sentie. Mais l’expression est surtout une métaphore héritée d’un geste très concret… et très ancien : le lavage au lavoir.Pendant des siècles, avant l’arrivée des machines à laver, le linge se nettoyait à la main, souvent au bord d’une rivière ou dans un lavoir communal. Et ce n’était pas une activité douce : on trempait, on savonnait, puis surtout on frottait fort, parfois avec une brosse, et on tapait le linge sur une pierre ou une planche pour en chasser la saleté. Un vrai travail de force. Plus un tissu était sale, plus il fallait l’attaquer avec énergie : savon, frottement, rinçage, recommencer.C’est exactement cette idée qu’on retrouve dans “passer un savon”. On n’est pas dans la petite remarque polie : on est dans le nettoyage intensif. Comme si la personne, par son comportement, avait besoin d’être “récurée” moralement. On veut lui enlever ses erreurs comme on enlève une tache tenace : en insistant, en frottant.L’expression s’inscrit d’ailleurs dans toute une famille d’images du même genre. On dit aussi “laver la tête” à quelqu’un, ou “lui passer un coup de brosse”. Dans ces formules, on retrouve l’idée que l’on corrige quelqu’un en le “nettoyant” : on lui remet les idées en place, on enlève ce qui ne va pas.Et le savon ajoute un petit supplément : au XIXe siècle notamment, les savons étaient parfois rugueux, agressifs, pas toujours parfumés comme aujourd’hui. Se faire savonner, c’était rarement agréable. Donc “passer un savon”, c’est aussi l’idée d’un reproche qui pique, qui gratte… comme un lavage au lavoir un peu violent.Conclusion : on dit “passer un savon” parce que, dans la langue, engueuler quelqu’un revient à le frotter moralement, comme on frottait autrefois le linge sale au lavoir : avec du savon, de l’énergie… et sans délicatesse.
Pourquoi dit-on “bravo” et “panique” ?
02:47|Le mot « bravo » vient de l’italien, où il signifie à l’origine « courageux », « vaillant », puis, par extension, « habile », « compétent ». Mais c’est surtout au XVIIIᵉ siècle, avec l’explosion de l’opéra italien, que « bravo » prend le sens qu’on lui connaît aujourd’hui : une acclamation adressée à un artiste.À l’époque, l’opéra est un véritable sport national en Italie. Le public ne se contente pas d’écouter : il juge, compare, applaudit, siffle… et célèbre les chanteurs vedettes, notamment les grandes divas et les castrats. Quand une aria est particulièrement réussie, les spectateurs crient « Bravo ! » pour saluer la performance.Très vite, le mot devient un code universel du théâtre et de la musique, puis franchit les frontières. La France l’adopte au XIXᵉ siècle, dans les salles d’opéra et de spectacle. Et détail intéressant : en italien, l’accord varie selon la personne applaudie : bravo pour un homme, brava pour une femme, bravi au pluriel. En français, on a gardé surtout la forme masculine singulière… devenue un cri d’encouragement pour tout le monde.Quant au mot « panique », il vient… d’un dieu. Et pas n’importe lequel : Pan, divinité grecque mi-homme mi-bouc, protecteur des troupeaux, des forêts et des montagnes.Dans l’Antiquité, Pan est un être sauvage, imprévisible, qui surgit au milieu des bois. On raconte qu’il aimait pousser des cris soudains, terrifiants, capables de déclencher une peur collective immédiate. Une peur qui n’a pas besoin de raison : on ne sait pas ce qu’on fuit, mais tout le monde fuit. C’est précisément ce que les Grecs appelaient φόβος πανικός (phobos panikos), littéralement : la “peur de Pan”.Ce n’était pas une frayeur ordinaire. C’était une décharge brutale, contagieuse, presque animale, typique des situations où un groupe perd toute maîtrise : une armée surprise, un troupeau affolé, des voyageurs qui croient entendre une présence invisible… Le mythe donne une explication à un phénomène psychologique très réel : la peur qui se propage comme un incendie.Le mot passe ensuite au latin, puis aux langues européennes. En français, « panique » apparaît au XVIIᵉ siècle, d’abord avec l’idée d’une terreur subite et irrationnelle. Aujourd’hui, la mythologie a disparu… mais le mécanisme reste identique : la panique, c’est quand le cerveau court plus vite que la raison.
Pourquoi votre opinion change-t-elle sans que vous vous en rendiez compte ?
03:02|La « fenêtre d’Overton » : voilà une expression qu’on entend de plus en plus en politique, dans les médias, sur les réseaux sociaux… et souvent sans qu’on sache exactement ce qu’elle veut dire. Pourtant, c’est un concept très simple, mais redoutablement efficace pour comprendre comment une société change d’avis.La fenêtre d’Overton désigne l’ensemble des idées considérées comme « acceptables » dans le débat public à un moment donné. Imaginez une fenêtre : à l’intérieur, on trouve les opinions que l’on peut défendre publiquement sans passer pour fou, dangereux ou extrémiste. En dehors de cette fenêtre, il y a les idées jugées inacceptables, impensables, scandaleuses.Le concept a été formulé dans les années 1990 par Joseph P. Overton, un analyste américain travaillant pour un think tank libéral, le Mackinac Center for Public Policy. Son intuition : ce ne sont pas uniquement les responsables politiques qui changent les lois, mais surtout ce que l’opinion publique considère comme « normal ». Autrement dit, un gouvernement ne peut généralement faire passer qu’une réforme déjà entrée, au moins un peu, dans la zone du « dicible ».À l’origine, Overton décrivait une sorte d’échelle : une idée peut être perçue comme impensable, puis radicale, ensuite acceptable, raisonnable, populaire… et enfin devenir une politique publique. Ce qui est fascinant, c’est que la fenêtre peut bouger dans les deux sens : vers plus de liberté, ou vers plus de restrictions.Prenons un exemple simple. Il y a 50 ans, parler de mariage homosexuel dans beaucoup de pays occidentaux aurait été considéré comme impensable. Puis le sujet est devenu discuté, défendu, normalisé, jusqu’à être légalisé dans de nombreux États. La fenêtre s’est déplacée.Autre exemple : la surveillance de masse. Avant les attentats du 11 septembre 2001, accepter des contrôles généralisés, des caméras partout, ou la collecte massive de données semblait choquant pour beaucoup. Puis, au nom de la sécurité, ces mesures sont devenues acceptables, parfois même demandées. Là encore, la fenêtre a bougé.Ce qui rend la fenêtre d’Overton si utile, c’est qu’elle explique une stratégie : pour faire accepter une idée, on peut d’abord la rendre « discutable ». Même si elle choque, on la met sur la table, on provoque un débat, on l’emballe dans des mots plus neutres, on trouve des exemples, on répète. Et petit à petit, ce qui était impensable devient simplement « une opinion parmi d’autres ».En résumé : la fenêtre d’Overton, c’est le thermomètre du débat public. Elle ne dit pas ce qui est vrai ou faux, mais ce qu’une société accepte d’entendre… et donc, ce qu’elle finira peut-être par tolérer, puis par adopter.
Dans quel pays est-il interdit de chanter en playback ?
02:07|Dans un seul pays au monde, ou presque, cette question n’est pas une blague, ni un simple débat artistique… mais une histoire de décret présidentiel.Ce pays, c’est le Turkménistan.Un État d’Asie centrale, fermé, autoritaire, riche en gaz naturel… et connu pour ses décisions politiques parfois totalement déroutantes. Parmi elles : l’interdiction du playback, c’est-à-dire l’art de bouger les lèvres sur une voix préenregistrée.Tout commence au début des années 2000, sous la présidence de Saparmourat Niazov, un dirigeant à la personnalité hors norme, qui réglemente la vie quotidienne jusque dans les détails les plus absurdes. Un jour, il s’en prend à ce qu’il considère comme un mensonge culturel : voir des artistes “faire semblant”.Pour lui, le playback est une imposture. Une tricherie. Une façon de tuer le talent.Et il ne se contente pas de critiquer : il tranche. Par décret, le playback est interdit lors des concerts, des événements culturels… mais aussi à la télévision. Et l’interdiction va encore plus loin : il devient même interdit d’utiliser de la musique enregistrée dans de nombreux événements publics, y compris parfois dans les mariages, où la musique doit être jouée en direct. L’objectif officiel ? Protéger l’“authenticité” et la culture turkmène. En réalité, c’est aussi une manière de contrôler la scène artistique, de cadrer ce qui doit être montré, et surtout de rappeler une règle essentielle dans le Turkménistan de l’époque : rien n’existe en public sans l’aval du pouvoir. Ce qui rend l’histoire encore plus frappante, c’est que cette logique de contrôle culturel continue sous ses successeurs. Les autorités turkmènes ont régulièrement imposé des règles strictes sur les performances, les styles, les chansons autorisées… et même sur la musique jouée dans les célébrations. En 2024 encore, des témoignages rapportent des consignes imposant une musique majoritairement nationale dans les mariages. Conclusion : au Turkménistan, le playback n’est pas seulement mal vu. Il est traité comme une menace. Parce que dans ce pays, la musique n’est pas qu’un divertissement : c’est un outil politique. Et même chanter… doit être “conforme”.