Partager
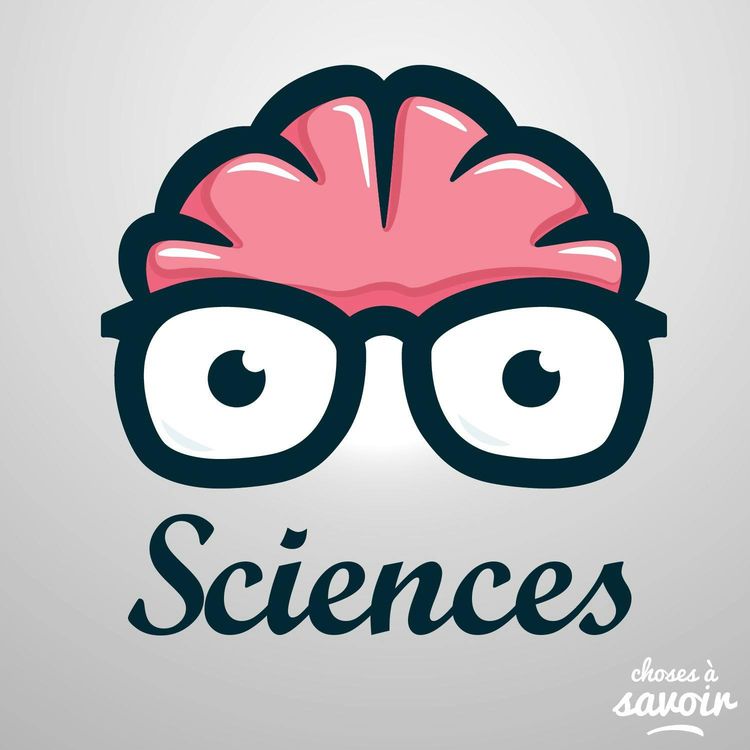
Choses à Savoir SCIENCES
Pourquoi a-t-il fallu 7 ans pour mettre en œuvre le mètre ?
Aujourd’hui, le mètre est une évidence. Il sert à mesurer nos tables, nos routes ou même la taille de nos enfants. Mais ce que l’on sait moins, c’est qu’il a fallu sept années d’efforts acharnés pour le définir avec précision. Et que cette aventure, à la fois scientifique et humaine, remonte à la Révolution française.
En 1790, l’idée d’unifier les unités de mesure s’impose. Jusqu’alors, chaque région utilisait ses propres unités : toises, pieds, coudées… Un véritable casse-tête ! L’Assemblée constituante décide alors de créer une unité universelle, fondée non pas sur le corps humain – comme la longueur d’un pied ou d’un bras – mais sur la Terre elle-même.
L’idée est audacieuse : mesurer un quart du méridien terrestre, c’est-à-dire la distance entre l’équateur et le pôle, puis diviser ce quart en dix millions de parties égales. L’une de ces parties deviendrait le mètre. Simple sur le papier… mais redoutablement complexe à réaliser.
Pour cette mission, deux astronomes sont désignés en 1791 : Jean-Baptiste Delambre et Pierre Méchain. Leur tâche ? Mesurer avec la plus grande précision possible la distance entre Dunkerque et Barcelone. Pourquoi ce trajet ? Parce qu’il traverse un arc de méridien, en passant par Paris.
Ils utilisent une méthode très rigoureuse pour l’époque : la triangulation. Elle consiste à créer un réseau de triangles entre des points élevés – clochers, tours, montagnes – et à en mesurer les angles pour calculer les distances. Le problème, c’est que chaque point nécessite des calculs précis, une installation minutieuse des instruments, et souvent des journées d’attente pour avoir un ciel dégagé.
À cela s’ajoutent les obstacles humains. Nous sommes en pleine Révolution, puis sous la Terreur. Les deux scientifiques sont souvent pris pour des espions avec leurs longues-vues et leurs plans. Ils doivent sans cesse expliquer leur mission aux autorités locales, parfois hostiles. Méchain, de son côté, est obsédé par l’exactitude, au point de refaire certains calculs pendant des mois, voire des années.
Au final, leur mission s’achève en 1798. Un an plus tard, en 1799, le mètre est officiellement adopté comme unité de mesure. Il est né d’une volonté de raison et de science, mais aussi d’un effort titanesque. Une unité universelle… issue d’une aventure humaine hors norme.
More episodes
View all episodes

Toutes les personnes aux yeux bleus ont-elles un ancêtre commun ?
01:57|Rediffusion On le sait, la couleur des yeux n'est souvent pas la même d'un individu à l'autre. Des scientifiques ont voulu connaître les raisons de ces modifications. Ils se sont notamment intéressés aux personnes ayant des yeux bleus. Leur étude a été menée à partir d'un groupe de 800 participants ayant cette particularité.Un examen génétique a montré que, dans la quasi totalité des cas, la couleur des yeux de ces personnes était due à une mutation génétique de l'iris, qui est en quelque sorte la partie colorée de l'œil.Et cette mutation génétique serait très ancienne, puisqu'elle remonterait à l'ère mésolithique. Cette période de la Préhistoire, comprise entre le paléolithique et le néolithique, s'étend environ entre 10.000 ans et 6.000 ans avant J.-C. Pour certains spécialistes, cependant, cette mutation serait beaucoup plus ancienne.À cette époque, d'après les scientifiques, tous les hommes avaient des yeux marron. Cette coloration dominante était due à la présence naturelle de mélanine brune dans l'œil, responsable de cette teinte majoritaire des yeux.Mais, à l'époque considérée, un homme aurait subi une mutation génétique de l'iris. Cette mutation aurait empêché la production de mélanine. Si les yeux de cet homme préhistorique étaient bleus et non marron, c'est d'abord du fait de cette mutation génétique, mais aussi en raison de la manière dont la lumière était dispersée dans l'iris.Aussi peut-on supposer que cet homme est l'ancêtre commun de toutes les personnes qui ont aujourd'hui les yeux bleus. Les scientifiques ont pu arriver à cette conclusion en constatant que les personnes ayant des yeux bleus possédaient le même "interrupteur" de mélanine, placé exactement de la même façon dans leur ADN.Une telle ressemblance génétique ne pouvait provenir que d'un héritage commun, celui légué par ce lointain ancêtre.Si les chercheurs ont bien identifié cette mutation génétique, ils n'en connaissent pas la cause. Ils se veulent en tous cas rassurants sur un point : un tel changement ne produit bien qu'une modification de la couleur des yeux, il n'a aucun impact sur la santé ni sur l'espérance de vie.
Quelle maladie le jeu Mario soignerait-il ?
01:45|Rediffusion Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la dépression toucherait plus de 300 millions de personnes dans le monde. Cette maladie, encore mal cernée par la médecine, serait même la première cause d'incapacité au travail.C'est dire à quel point son traitement est un enjeu majeur de santé publique. La récente étude menée par des chercheurs allemands pourrait représenter, à cet égard, une réponse originale.Elle souligne en effet le rôle thérapeutique de certains jeux vidéo. En l'occurrence "Super Mario odyssey", l'un des jeux où apparaît ce célèbre personnage imaginé par un créateur et producteur japonais de jeux vidéo.46 personnes, souffrant de dépression, ont participé à l'étude en question, qui a duré 6 semaines. Les chercheurs les ont divisées en trois groupes. Le premier a reçu un traitement traditionnel, à base de médicaments.Les participants du second groupe devaient utiliser un logiciel conçu pour développer les fonctions cognitives, celles-ci pouvant être affectées par la dépression. Quant aux personnes composant le dernier groupe, elles étaient tout bonnement invitées à jouer au jeu "Super Mario". Elles ont eu droit à 18 sessions de jeu, chacune durant environ trois quarts d'heure.Or, c'est dans ce dernier groupe qu'on observe la régression la plus significative des symptômes liés à la dépression. Et ce sont ses membres qui, sans surprise, ont manifesté le plus de motivation à poursuivre leur traitement.Les scientifiques rappellent que, quel que soit l'impact positif de ces jeux vidéo sur la maladie, ils ne sauraient à eux seuls soigner la dépression. En effet, de telles séances de jeu ne peuvent qu'en atténuer certains symptômes.Les chercheurs ont ainsi constaté, chez les joueurs, un meilleur bien-être subjectif et une plus grande capacité à utiliser des informations visuelles, souvent mise à mal par la dépression.Par l'état de concentration qu'il requiert, le jeu vidéo laisserait également peu de place aux pensées négatives, qui envahissent l'univers mental des personnes dépressives. D'autres recherches seront cependant nécessaires pour établir la réelle efficacité des jeux vidéo dans le traitement de la dépression.
Les personnes les plus riches sont-elles les plus intelligentes ?
02:00|Rediffusion Dans nos sociétés occidentales, le mérite, comme vecteur de réussite professionnelle, joue un rôle essentiel. On considère souvent que, dans ces conditions, l'intelligence est le principal moteur de l'ascension sociale, et donc de l'accès à des professions mieux rémunérées.En résumé, les personnes intelligentes sont plus riches que les autres. Or une récente étude vient contredire, du moins en partie, une telle affirmation.Elle a porté sur plus de 59.000 Suédois, qui ont tous subi un test d'aptitudes cognitives. Il s'agit donc d'un échantillon assez large, qui se signale aussi par la diversité des professions exercées et des rémunérations perçues.Cependant, cette recherche ne concerne que des hommes, issues d'une seule nationalité. c'est là une limite à prendre en compte.Les auteurs de l'étude ne remettent pas en cause le lien entre les capacités intellectuelles d'un individu et sa réussite professionnelle. Cette corrélation a d'ailleurs été mise en évidence par de précédentes recherches.Cette étude, cependant, tend à la relativiser. En effet, ses résultats montrent qu'au-delà d'un certain niveau de salaire, les aptitudes de la personne qui le gagnent semblent stagner. Comme si elles atteignaient un seuil, impossible à dépasser.De fait, cette étude indique qu'au-delà d'un salaire annuel de 60.000 euros, gagné par 1 % des participants, les résultats de ces derniers aux tests étaient inférieurs à ceux des personnes gagnant un peu moins d'argent qu'eux.Ce qui tendrait à prouver que l'accès à ces postes très bien rémunérés ne dépend pas seulement des aptitudes intellectuelles. D'autres facteurs expliqueraient le succès d'un parcours professionnel.L'appartenance à certains milieux sociaux serait l'un d'entre eux. Dans ce cas, les relations que peut faire jouer la famille, et l'éducation soignée qu'elle ne manque pas de donner aux enfants, peuvent faire avancer une carrière plus sûrement que la seule possession de capacités intellectuelles.Certains traits de personnalité ne sont pas non plus sans influence sur un parcours professionnel. Mais la chance peut aussi jouer un rôle, offrant, à certains moments, des opportunités de carrière à ceux qui savent les saisir.
Partageons-nous vraiment 50% de nos gênes avec les bananes ?
01:53|Rediffusion Si certaines affirmations ont toutes les chances de passer à la postérité, c'est qu'elles frappent par leur singularité. C'est bien le cas de l'assertion, souvent entendue, selon laquelle l'homme partagerait la moitié de ses gènes avec les bananes.Certains scientifiques en ont fait état après le décodage, en 2012, du génome complet de la banane. Un résultat acquis au terme de longs travaux.En théorie, il est vrai, l'idée n'a rien d'absurde. En effet, d'après les spécialistes, l'être humain et les plantes auraient un ancêtre commun, qui aurait vécu voilà environ 1,5 milliard d'années.Il est donc normal que nous partagions certains gènes avec les bananes, mais aussi avec d'autres plantes.Mais de là à penser que nous avons 50 % de notre patrimoine génétique en commun avec la banane, il y a un pas que beaucoup d'abstiennent de franchir.Il faut d'abord rappeler, en effet, que le génome de la banane est 6 fois plus petit que celui que l'homme. Ce qui rend déjà difficile un partage de la moitié de nos gènes avec les bananes.Ensuite, il faut savoir de quels gènes on parle. Ceux que nous partagerions avec les bananes, à hauteur de 50 %, sont les gènes codants. Autrement dit ceux qui contiennent l'information nécessaire à la fabrication d'une protéine.L'homme possède environ 20.000 gènes codants et la banane 36.000. Mais ces gènes codants ne représentent que de 2 à 5 % de l'ADN total. Nous aurions donc, en commun avec les bananes, une toute petite partie de nos gènes et, selon les estimations des spécialistes, environ 1 % de notre ADN total.L'affirmation selon laquelle nous partagerions 50 % de nos gènes avec les bananes vient sans doute des récentes recherches menées par des scientifiques américains. En effet, ils ont identifié, non pas des gènes codants identiques, entre l'homme et la banane, mais des gènes homologues, à hauteur de 60 %.Il s'agit donc de gènes (représentant eux-mêmes une très faible proportion de l'ADN) qui contiennent des informations comparables, mais non pas identiques, relatives aux protéines qu'ils permettent de fabriquer.
Quel animal serait le dernier à survivre en cas de fin du monde ?
02:04|Rediffusion La Terre a déjà connu des épisodes tragiques, au cours desquels la vie a paru menacée. On se souvient ainsi de l'extinction des dinosaures, survenue voilà 65 millions d'années.Mais la crise du Permien-Trias, il y a environ 252 millions d'années, fut encore plus grave. Provoquée par l'éruption d'un supervolcan ou des impacts de météorites, elle se traduit par la disparition des trois quarts des animaux terrestres et de la quasi-totalité des espèces marines.Si un épisode aussi dramatique survenait aujourd'hui, ou une guerre nucléaire, quel serait le dernier animal à survivre ?Si l'on en croit les films et les récits de science-fiction, l'espèce humaine serait la plus résistante. Son ingéniosité et sa technologie lui permettraient de survivre à de telles catastrophes.Or un tel scénario appartient plus à la fiction qu'à la réalité. En effet, les hommes ne pourraient résister aux conséquences d'une guerre nucléaire ou aux effets de la formidable explosion d'une supernova trop proche de la Terre.Il existe cependant un animal capable de survivre à de tels événements. Ce n'est pas le cafard, pourtant très résistant. L'animal en question est encore plus petit, et il ne cesse de provoquer l'étonnement des scientifiques.Ce curieux animal, dont les huit pattes se terminent par des griffes, s'appelle le tardigrade. Il mesure entre 0,1 millimètre et un peu plus d'un millimètre. À vrai dire, cet "ourson d'eau" microscopique, comme on le surnomme aussi, était déjà connu pour pouvoir s'adapter à des conditions extrêmes.En effet, le tardigrade est capable de supporter des températures allant de -272°C à 150°C. Il peut aussi résister à des pressions s'élevant jusqu'à 6 000 bars et vivre sans eau.C'est pourquoi on trouve ce champion de la survie dans les profondeurs de l'océan comme sur les plus hauts sommets de l'Himalaya. Aussi le tardigrade a-t-il toutes les chances de vivre bien plus longtemps que les hommes.D'après les scientifiques, seule l'extinction du Soleil, qui entraînera la disparition de l'atmosphère terrestre, pourrait avoir raison de lui.
Pourquoi Pékin a-t-elle un Bureau des modifications météorologiques ?
02:03|Rediffusion Le fatalisme observé depuis toujours face aux éléments n'est plus de mise au XXIe siècle. En effet, il existe aujourd'hui des techniques permettant d'influer sur le temps.Certains pays se sont même dotés, pour atteindre ce but, de structures ad hoc. C'est notamment le cas de la Chine, qui a mis en place, en 1973, un Bureau des modifications météorologiques.Les techniciens qui y travaillent emploient diverses méthodes pour modifier le temps. La plus répandue est l'"ensemencement des nuages". Elle consiste à bombarder les nuages, depuis le sol ou à partir d'avions, avec des substances comme le sel, ou plus souvent, l'iodure d'argent.Il existe d'autres techniques, comme l'envoi de décharges électriques dans les nuages. En tout, ce programme de changement du temps, commencé en 2002, s'est traduit par plus de 560.000 modifications des conditions météorologiques.Mais pourquoi la Chine veut-elle ainsi faire la pluie et le beau temps ? Le but essentiel est de favoriser le temps le plus propice à l'économie. Ainsi, le Bureau des modifications météorologiques a-t-il pour mission de lutter contre les nombreux épisodes de sécheresse qui frappent le pays.Si l'on en croit les responsables chinois, les résultats seraient assez probants. En effet, les techniques utilisées auraient augmenté de 10 % les précipitations tombant sur Pékin en 2004.Au total, le personnel du Bureau aurait provoqué près de 490 milliards de tonnes de pluie, soit l'équivalent de trois fois le contenu de l'immense barrage chinois des Trois Gorges. Des précipitations qui ne doivent pas seulement arroser les récoltes mais aussi éteindre les nombreux incendies qui se déclenchent ici et là dans le pays.Mais le Bureau poursuit encore d'autres objectifs. Les méthodes mises en œuvre doivent aussi empêcher des averses de grêle désastreuses pour les cultures.Parfois, il ne s'agit pas de faire pleuvoir, mais d'éviter la pluie à un certain moment. Ainsi, grâce au Bureau, les Jeux olympiques de Pékin, en 2008, se sont déroulés sous un beau soleil.D'ici 2025, ce programme de modification du temps devrait s'étendre à d'autres régions.
Le Soleil tourne-t-il sur lui même ?
02:11|Rediffusion Au cœur du système qui porte son nom, le Soleil est apparu voilà environ 4,5 milliards d'années. On sait, depuis Galilée et Copernic, que la Terre autour de notre étoile.Mais qu'en est-il du Soleil ? Est-il affecté, lui aussi, d'un mouvement de rotation ? La réponse est doublement affirmative, si l'on peut dire. En effet, non seulement le Soleil tourne autour du centre de notre galaxie, la Voie lactée, mais il tourne aussi sur lui-même.La vitesse de rotation de notre astre n'est d'ailleurs pas uniforme. En effet, le Soleil n'étant pas à proprement parler un corps solide, mais le résultat d'un assemblage de gaz, les diverses régions qui le composent se meuvent à des vitesses différentes.La durée de rotation est en effet très variée. Ainsi, le cœur du Soleil tourne beaucoup plus vite que sa surface. Et ce rythme dépend lui-même de la région considérée. De fait, l'équateur tourne sur lui-même en 25 jours, alors qu'il en faut 10 de plus aux pôles pour accomplir cette révolution.Ceci étant, les spécialistes estiment que le Soleil tourne autour de lui-même à une vitesse moyenne de près de 2.000 km par seconde. Et cette révolution s'accomplit dans le même sens que celui des planètes tournant autour de l'astre.C'est notamment l'étude des taches solaires, découvertes par Galilée, qui a permis de comprendre que le Soleil tournait lentement autour de lui-même.Cette rotation de notre étoile serait en partie liée à son origine. En effet, le Soleil serait apparu au sein d'une vaste nébuleuse, à la suite de l'effondrement d'un nuage de gaz sur lui-même, lié à l'effet de la gravité.Sous l'effet de ce phénomène, la vitesse de rotation du nuage en train de s'effondrer se serait accentuée. Un peu comme celle du patineur qui s'accroupit. La rotation actuelle du Soleil serait donc un vestige de cette accélération.Mais d'autres facteurs devraient être pris en compte pour expliquer un phénomène par ailleurs assez mal connu. Parmi eux, le magnétisme du Soleil a pu jouer un rôle dans cette mise en mouvement de notre étoile.
La perception du temps a-t-elle un impact sur la guérison ?
01:53|Rediffusion On se doutait que des facteurs psychiques ou psychologiques pouvaient influer aussi bien sur l'apparition que sur la guérison d'une maladie. Une récente étude américaine le confirme, en montrant que la manière dont nous percevons le temps, au cours de la convalescence, peut jouer sur la guérison.Les résultats de ce travail s'appuient sur une recherche menée auprès de 33 participants. Ils ont d'abord accepté qu'on leur applique, de manière contrôlée, des ventouses, qui ont produit de petites ecchymoses sans gravité.Puis les chercheurs ont réussi à manipuler la perception du temps chez les volontaires, en utilisant, pour ce faire, des horloges avançant plus ou moins vite. Ils ont alors constaté que les personnes ayant le sentiment que le temps s'écoulait lentement guérissaient moins vite que celles confrontées à un temps perçu comme rapide.Bien entendu, le temps passait de la même façon pour tous les patients, mais les chercheurs ont réussi à en modifier la perception.Cette étude montre que le corps et l'esprit semblent liés d'une manière encore plus étroite qu'on ne le croyait. Au point qu'une perception aussi abstraite que la notion que nous avons de l'écoulement du temps pourrait influer sur la guérison d'une maladie.En effet, il ne s'agit pas là de l'influence exercée par le passage réel du temps, mais par la perception qu'en a chacun de nous. Avec cette idée, plus ou moins consciente, que la durée de convalescence joue un rôle dans la guérison finale.Ces recherches confirment donc l'importance du psychisme dans le processus de guérison. Même si des recherches plus approfondies seront nécessaires pour mieux connaître ces mécanismes, le facteur psychologique pourrait être, d'ores et déjà, mieux pris en compte.Ce qui permettrait de proposer aux patients des traitements intégrant davantage les effets du psychisme dans les processus de cure. Il s'agirait en somme d'une approche thérapeutique holistique, qui envisagerait le patient, non plus seulement dans sa dimension physiologique, mais dans la globalité de son être.
Comment les loups de Tchernobyl auraient-ils muté ?
01:55|RediffusionLes expériences sur les animaux, désapprouvées par certains, permettent souvent de faire progresser nos connaissances sur les maladies humaines. Mais leur simple observation, dans la nature, aide aussi les scientifiques à mieux en comprendre les mécanismes.C'est ce qu'a constaté une équipe de chercheurs américains, qui s'est rendue à Tchernobyl, en 2014, pour voir comment les loups supportaient les radiations. Ces animaux sont en effet nombreux à errer sur ce site, marqué par un très grave incident nucléaire en avril 1986.Durant près de dix ans, les scientifiques ont prélevé des échantillons de sang sur ces canidés et recueilli des informations, grâce à des colliers GPS attachés à leur cou.Après toutes ces années d'investigations, les chercheurs américains viennent de donner le résultat de leurs recherches. Ils se sont aperçus que, comme on pouvait s'y attendre, ces loups étaient exposés à de très forts taux de radiations.Ils étaient même six fois plus élevés que le seuil maximal, qu'un humain ne pouvait dépasser sans faire courir un grave danger à sa santé. Mais alors comment faisaient ces animaux pour survivre à une telle dose de radiations ?C'est là le point le plus intéressant des découvertes de cette équipe de scientifiques. Ils ont en effet remarqué que certains animaux avaient développé une mutation génétique propre à les protéger contre le cancer.Les chercheurs ont pu identifier les parties du génome de ces loups qui semblaient insensibles, dans une certaine mesure, aux attaques de la maladie. En fait, le système immunitaire de ces animaux s'apparentait à celui d'un patient atteint du cancer mais bénéficiant de séances de radiothérapie.Cette découverte sur la faculté qu'auraient certaines mutations génétiques de résister aux atteintes du cancer est d'autant plus importante que l'homme réagit à la maladie de la même manière que ces loups.Ces recherches prometteuses sont malheureusement freinées par l'actuel conflit en Ukraine, qui rend l'accès à la zone de Tchernobyl très difficile. Il faudra donc patienter encore avant d'en voir les premiers résultats concrets.