Partager

In Extenso
Jeunes de quartier : "2005 ça a marqué l'histoire"
Banlieues, quartiers, cités. En France ces mots ont trop souvent une connotation négative. Ce que l’État français nomme depuis 2018 les quartiers prioritaires de la politique de la ville regroupe 5,4 millions d’habitants dont 40% ont moins de 25 ans. Mais qu’est-ce qu’être jeune dans un quartier populaire ? La [recherche participative Pop-Part, conduite dans dix villes ou quartiers de l’Île-de-France, et portée notamment par l'Université Paris Nanterre, s’est associé à 120 jeunes pour se saisir du sujet.
Nous recevons pour ce nouvel épisode, la politologue Hélène Hatzfeld et Nawufal Mohammed habitant de Clichy-Sous-bois de 32 ans. Il est agent de développement, c'est-à-dire qu'il aide les habitants à s'approprier les nouveaux logements et les espaces publics.
En 2005, à la suite de la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré à Clichy-sous-Bois, des révoltes ont eu lieu en réaction. Les jours suivants des révoltes de jeunes de quartier populaires gagnent l'ensemble du pays, en réponse le gouvernement instaure l'état d'urgence, un couvre feu et mobilise de nombreux policiers. Dans son premier discours après les émeutes le président de République de l'époque, Jacques Chirac, promet de créer plus d'opportunités pour les jeunes de quartiers. Les gouvernement suivant mettront également en place des mesures similaires durant leurs mandats.
Les quartiers sont des territoires spécifiques ou la délinquance est combattue par les pouvoirs publics par des mesures sécuritaires spéciales. Les habitants sont dès le plus jeune âge en contact avec des policiers.
Extraits
Something elated, Broke for free, 2011
Émeutes des banlieues : retour dix ans en arrière, France 24 (2015)
Crédits
Conception et Animation Nils Buchsbaum, Réalisation Romain Pollet, Chargé de production, Rayane Meguenni
More episodes
View all episodes
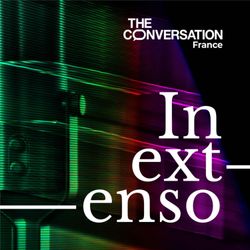
Au temps de « l’urgence écologique »
43:10|À mesure que les scientifiques documentent toujours plus finement les effets du réchauffement climatique sur notre système Terre, le temps de la crise écologique s'impose comme celui de l'urgence absolue. Comment attendre une minute de plus face à la montée des périls environnementaux ?Cette urgence ne date toutefois pas d'hier : ces dernières décennies, les prises de conscience écologiques se succèdent sans que rien ne semble pouvoir inverser les mouvements délétères des destructions et dégradations de notre environnement.Comment expliquer cela ? Au fait que « la matrice du temps écologique se situe hors du temps des sociétés humaines », souligne l’historien Grégory Quenet, invité de ce nouveau podcast de The Conversation France, aux côtés de l’anthropologue Verónica Calvo Valenzuela et du théologien Olric de Gelis. Tout trois sont membres de la Chaire Laudato Si du Collège des Bernardins. Initiée en 2021, ce cycle de recherche « pour une nouvelle exploration de la Terre » prendra fin au printemps 2024. Conception, Jennifer Gallé. Réalisation, Romain Pollet.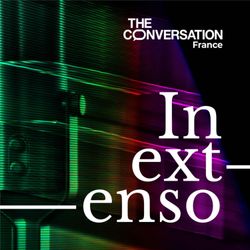
Défis climatiques : Trouver de nouvelles boussoles économiques pour permettre le changement
24:51|Dans ce nouvel épisode, on s’intéresse aux enjeux économiques et à leur rôle dans la crise climatique. Notre obsession pour la croissance est-elle responsable de la crise climatique et plus généralement des dérèglements environnementaux ? Sur quels nouveaux indicateurs économiques s’appuyer pour assurer la survie de la biosphère ? Après la pandémie de Covid, pourquoi mettre la question de la santé et du bien-être au cœur de ces enjeux est devenu incontournable pour envisager l’avenir ?Autant de questions que nous abordons avec Éloi Laurent, enseignant à Sciences Po et à l’Université de Stanford, économiste senior à l’Observatoire français des conjonctures économiques. Ses travaux portent sur les questions de bien-être et de soutenabilité environnementale. On peut trouver ses deux derniers ouvrages, Sortir de la croissance, Et si la santé guidait le monde ? en édition de poche.Credits, conception et animation, Françoise Mamouyet & Jennifer Gallé. Réalisation, Romain Pollet. Chargé de production, Rayane Meguenni.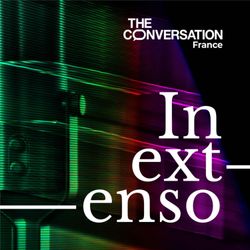
À bas les murs : en Russie, une opposition hors les murs ?
21:32|Aujourd'hui, Antoine Arjakovsky, directeur de recherche au Collège des Bernardins, fondateur de l’Institut d’études œcuméniques de Lviv et auteur de plusieurs ouvrages dont Occident-Russie : Comment sortir du conflit ?, revient sur un mur moins physique, mais tout aussi infranchissable : celui qui sépare l’opposition russe à Vladimir Poutine, emprisonnée, réduite au silence ou contrainte à l'exil, de ses concitoyens.Une opposition dont plusieurs représentants se sont notamment réunis lors de la dernière édition du Forum Normandie, en présence d'Antoine Arjakovsky, pour rédiger ensemble un texte appelant à la fin de l'agression russe contre Ukraine et à la démocratisation de leur pays. Ces objectifs relèvent-ils du voeu pieux ? Comment les pays qui accueillent ces opposants peuvent-ils les aider ?Crédits, conception et animation, Grégory Rayko. Réalisation, Rayane Meguenni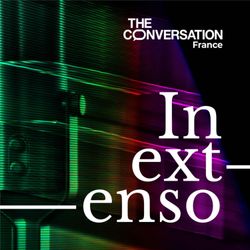
Assister à un match de foot ou aller à l'opéra, est-ce vivre la même expérience esthétique?
16:25|Si l’expérience esthétique est universelle, chaque milieu social en définitcependant les formes et le format. Cette simple considération permet de réintégrer dans le même domaine les arts dits « légitimes », et des ensembles de pratiques culturelles considérées comme « illégitimes » dont pourtant, l’expérience esthétique est tout à fait similaire. Au lieu de définir la culture en se penchant sur différents objets culturels, Fabrice Raffin nous propose de l'aborder par le prisme de l'expérience, en adoptant un point de vue sociologique. Le moment de l'expérience esthétique culturelle a toujours une fonction sociale, définie par des règles précises : il est par exemple autorisé d'exprimer ses émotions, quand l'expérience est collective - pleurer au cinéma, crier au concert, chanter à un match de foot… Et même quand nous vivons ces expériences seuls, il s'agit encore de s'inscrire dans une communauté d'appartenance. Enfin, cette expérience émotionnelle et physique peut également être associée à la notion de plaisir - n'en déplaise à la conception philosophique héritée de Kant et Hegel. Crédits : conception et animation, Sonia Zannad ; réalisation, production, Rayane Meguenni.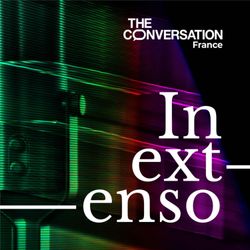
72. Défis globaux… solutions locales ! (3/3)
36:47||Saison 1, Ep. 72Le mois de décembre 2022 va constituer un moment important de la protection de la biodiversité au niveau mondial avec la tenue, à Montréal, de la COP15 (7-19 décembre). Son objectif sera de définir le nouveau cadre de cette protection pour la décennie à venir. Le contexte de la sixième extinction de masse réclame des actions fortes et sans délai pour préserver les écosystèmes naturels terrestres, dont les sociétés humaines tirent une variété infinie de services (on les appelle « services écosystémiques »). L’un des points clés en cours de discussion concerne la protection de l’intégrité de ces écosystèmes naturels sur 30 % des terres et des mers à échéance de 2030 (pour les mers, sont concernées les zones sous juridiction nationale). C’est ce que l’on appelle « l’objectif 30x30 ». Cette dynamique d’expansion des aires protégées constitue aujourd'hui l'un des axes principaux de la protection du patrimoine naturel mondial. Si les êtres humains ont toujours cherché à protéger des territoires particuliers, de manière temporaire ou permanente, ce qu'on définit aujourd'hui comme « aires protégées » est apparu dans la seconde moitié du XIXe siècle. Parmi ces premiers espaces figurent, par exemple, la « réserve artistique » de la forêt de Fontainebleau, créée en 1861, le parc régional du Yosemite (États-Unis, 1864) ou encore le parc national du Yellowstone (États-Unis).Les aires protégées existent dans presque tous les pays du monde, présentant des tailles très différentes d’un continent à l’autre. Elles répondent également à une classification précise en six catégories, établie par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Mais que signifie concrètement « protéger » 30% de la planète ? Et comment cela se passe-t-il sur le terrain ? Ces espaces représentent-ils une « mise sous cloche », comme l’avancent leurs détracteurs ? Cette politique des aires protégées se fait-elle aux dépens des populations qui y vivent ? Et comment savoir si elles sont efficaces ? Crédits : conception et animation, Jennifer Gallé. Réalisation et production, Rayane Meguenni
79. Défis climatiques : que peuvent les scientifiques face à un climat toujours plus contrasté ?
28:30||Saison 1, Ep. 79Sécheresse et canicules inédites, montée des eaux, biodiversité en chute libre… Partout dans le monde, les effets de la crise climatique se font sentir, de plus en plus intensément. Face à ce constat, documenté par les scientifiques dans les fameux rapports du GIEC, certains vivent dans la crainte qu’un point de non-retour soit atteint.Et si, au-delà des chiffres et des situations effrayantes, on s’intéressait aux initiatives qui portent leurs fruits ? C’est l’objet de « Défis climatiques : ces initiatives qui font bouger les lignes » une série de cinq podcasts réalisée en partenariat avec l’Institut des hautes études pour la science et la technologie. Objectif : appréhender les mobilisations et les actions qui permettent de faire face à la crise climatique et qui donnent de l’espoir.Dans ce troisième épisode, on revient sur les phénomènes récents de la sécheresse, comme celle qui a touché la France à l’été 2022, et des inondations, exceptionnelles comme au Pakistan où les pluies de mousson ont causé un grand nombre de victimes. Sous l’effet des dérèglements climatiques, notre météo devient de plus en plus contrastée. Comment les travaux de modélisation et les prévisions des scientifiques peuvent-ils nous permettre de mieux appréhender ces situations ?Pour revenir sur ces évolutions et ce qui nous attend, nous recevons l’hydrologue Vazken Andréassian, hydrologue et directeur de l'unité de recherche HYCAR (Inrae), dont les travaux portent sur la modélisation hydrologique.Crédits, conception et animation, Françoise Mamouyet & Jennifer Gallé. Réalisation, Romain Pollet. Chargé de production, Rayane Meguenni. Musique, « Night », Kosmorider, 2022.
80. À bas les murs : Gorbatchev-Poutine, d'un mur à l'autre
20:09||Saison 1, Ep. 80La cinquième édition du Forum mondial Normandie pour la Paix – une manifestation annuelle dont The Conversation France est partenaire — s'est déroulée cette année les 23 et 24 septembre sous le mot d'ordre « À bas les murs ! Ces enfermements qui font les guerres ». Dans la continuité de ces deux journées qui ont donné lieu à une vingtaine de conférences et débats entre universitaires, responsables politiques et personnalités de la société civile, nous vous proposons deux podcasts, avec deux intervenants au Forum : l'historienne Sabine Dullin (Sciences Po), spécialiste de la Russie et de l'URSS, et le politologue Patrick Maurus (Inalco), expert des deux Corées.Le premier épisode, en compagnie de Sabine Dullin, revient sur les 28 années d'existence de l'un des murs les plus célèbres de l'Histoire : celui de Berlin, érigé en 1961 et abattu en 1989.Ce sinistre édifice qui entourait la totalité de Berlin Ouest était immédiatement devenu le symbole de la division de l'Europe, voire du monde, en deux camps antagonistes. Sa chute, rapidement suivie de celle de l'URSS et de l'ensemble du « bloc communiste », avait, croyait-on, annoncé l'avènement d'une ère de paix et de coopération. Mais un nouveau schisme s'est progressivement fait jour entre la Russie et le reste de l'Europe. Tandis que la plupart des anciens satellites de Moscou intégraient l'Otan, un revanchisme russe de plus en plus sensible s'est exprimé, dont l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022 a été l'aboutissement sanglant. Si bien que le continent apparaît aujourd'hui plus que jamais scindé en deux parties…Sabine Dullin, qui a notamment publié La Frontière épaisse (éditions EHESS) en 2014, un Atlas de la guerre froide (éditions Autrement) en 2017 et L'Ironie du destin. Une histoire des Russes et de leur Empire (éditions Payot) en 2021, nous permet de mieux comprendre ces processus qui semblent condamner l'Europe à des scissions sans cesse renouvelées. Crédits, conception et animation, Grégory Rayko. Réalisation, Rayane Meguenni.
78. Défis climatiques : la justice, un outil de plus en plus efficace ?
27:10||Saison 1, Ep. 78Sécheresse et canicules inédites, montée des eaux, biodiversité en chute libre… Partout dans le monde, les effets de la crise climatique se font sentir, de plus en plus intensément. Face à ce constat, documenté par les scientifiques dans les fameux rapports du GIEC, certains vivent dans la crainte qu’un point de non-retour soit atteint.Et si, au-delà des chiffres et des situations effrayantes, on s’intéressait aux initiatives qui portent leurs fruits ? C’est l’objet de « Défis climatiques : ces initiatives qui font bouger les lignes » une série de cinq podcasts réalisée en partenariat avec l’Institut des hautes études pour la science et la technologie. Objectif : appréhender les mobilisations et les actions qui permettent de faire face à la crise climatique et qui donnent de l’espoir.Dans ce deuxième épisode, on s'aventure sur le terrain de la justice et du droit. Depuis quelques années, la justice climatique prend de l'ampleur. En France et ailleurs dans le monde, des citoyens saisissent des tribunaux pour dénoncer «l'inaction climatique » et tenterd'agir en faveur de l'environnement. Quelle est la portée de ces nouvelles formes de mobilisation ?Pour nous éclairer sur ces questions, nous recevons la juriste et chercheuse Judith Rochfeld, professeur de droit privé à l'université Paris 1-Panthéon-Sorbonne. Judith Rochfeld a codirigé le Dictionnaire des biens communs et a publié en 2020 un essai intitulé Justice pour le climat, les nouvelles formes de mobilisations citoyennes.Crédits, conception et animation, Françoise Mamouyet & Jennifer Gallé. Réalisation, Romain Pollet. Chargé de production, Rayane Meguenni Musique, « Night », Kosmorider, 2022
77. Défis climatiques : à quelle échelle agir ?
24:51||Saison 1, Ep. 77Sécheresse et canicules inédites, montée des eaux, biodiversité en chute libre... Partout dans le monde, les effets de la crise climatique se font sentir, de plus en plus intensément. Face à ce constat, documenté par les scientifiques dans les fameux rapports du GIEC, certains vivent dans la crainte qu'un point de non-retour soit atteint.Et si, au-delà des chiffres et des situations effrayantes, on s'intéressait aux initiatives qui portent leurs fruits ? C'est l'objet de « Défis climatiques : ces initiatives qui font bouger les lignes » une série de 5 podcasts réalisée en partenariat avec l'Institut des hautes études pour la science et la technologie. Objectif : appréhender les mobilisations et les actions qui permettent de faire face à la crise climatique et qui donnent de l'espoir.Dans ce premier épisode, on s'interroge sur les leviers efficaces d'action : à quelle échelle agir –au global, au local, en réseau ? On tentera aussi decomprendre ce qui peut favoriser l'action ou, au contraire, l'inhiber. Pour nous accompagner dans cette réflexion nous recevons Catherine Larrère professeur émérite à l'université Paris I-Panthéon-Sorbonne. Précurseuse, en France, de la philosophie environnementale, Catherine Larrère a écrit plusieurs ouvrages dans ce domaine, dont un certain nombre avec son mari l'agronome et sociologue Raphaël Larrère. Leur dernier livre, « Le pire n'est pas certain », a été publié en septembre 2020 aux éditions Premiers Parallèle.Crédits, conception et animation, Françoise Mamouyet & Jennifer Gallé. Réalisation, Romain Pollet. Chargé de production, Rayane Meguenni Musique, « Night », Kosmorider, 2022.