Partager
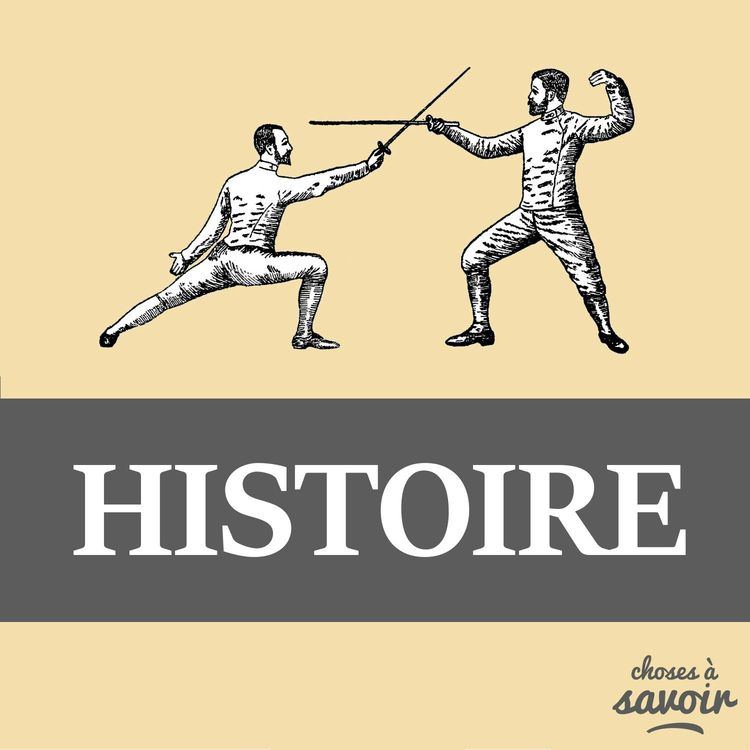
Choses à Savoir HISTOIRE
Quelle fut la première grève de l'histoire ?
Les réactions face à l'actuel projet de réforme des retraites vient encore le rappeler : la grève est l'un des principaux moyens de contestation dans notre pays. Depuis la Révolution française, notamment, elle ponctue l'histoire des revendications sociales et du mouvement ouvrier.
Mais la grève, qui n'est pas l'apanage de la France, n'est pas non plus cantonnée à l'histoire contemporaine. En effet, c'est un phénomène qui remonte beaucoup plus haut dans le temps.
Et les historiens ont même identifié la grève la plus ancienne. Elle aurait eu lieu en Égypte, 2.100 ans avant notre ère ! Nous sommes à Thèbes, sur la rive orientale du Nil.
Les serviteurs d'un temple de cette ville arrêtent de travailler et exposent leurs revendications au gouverneur. Ils ne reprendront pas le travail tant qu'on ne leur distribuera pas deux galettes supplémentaires par jour.
L'Égypte ancienne est décidément le lieu de naissance de la grève, conçue comme un moyen de pression pour obtenir la satisfaction de ses revendications. Ainsi, en 1166 avant J.-C., un papyrus rend compte, pour la première fois, de l'un de ces mouvements sociaux.
Il concerne les artisans et les ouvriers qui édifient les tombeaux des pharaons dans la Vallée des Rois, une région située sur la rive occidentale du Nil, en face de Thèbes.
Les artisans réclament leur salaire, qui ne leur a pas été payé, et se plaignent de manquer de nourriture. Ils cessent donc le travail pour réclamer une amélioration de leur situation.
La grève a ensuite atteint d'autres contrées, comme la Grèce classique. C'est du moins ce que laisse supposer Aristophane qui, dans sa comédie "Lysistrata", écrite au Ve siècle avant J.-C., met en scène des femmes qui, pour contraindre les hommes à cesser la guerre, refusent de coucher avec eux.
Il s'agit là d'une forme de grève assez originale. Plus classique, en revanche, la grève qui éclate en France, en 1229, quand, à la suite de la répression violente d'une rixe, qui se traduit par la mort de nombreux étudiants, ces derniers décident de boycotter les cours de l'Université de Paris.
More episodes
View all episodes

Quel attentat a échoué à une lettre près ?
02:33|La conspiration des poudres de 1605 est l’un des attentats politiques les plus célèbres de l’histoire britannique. Un projet radical : faire exploser le Parlement anglais pour décapiter le pouvoir d’un seul coup. Nous sommes dans l’Angleterre du début du XVIIᵉ siècle, sous le règne du roi Jacques Ier.Pour comprendre, il faut revenir au contexte religieux. Depuis la Réforme, l’Angleterre est officiellement protestante. Les catholiques, minoritaires, subissent une série de restrictions : amendes pour ceux qui refusent d’assister au culte anglican, exclusion de certaines fonctions, suspicion permanente. Beaucoup espèrent qu’avec Jacques Ier — qui succède à Élisabeth Iʳᵉ en 1603 — les tensions vont s’apaiser. Mais le roi maintient une politique dure.C’est dans ce climat qu’un petit groupe de catholiques anglais décide de passer à l’action. Leur chef est Robert Catesby, noble charismatique et déterminé. Le plan est simple et terrifiant : stocker des barils de poudre sous la Chambre des Lords, puis les faire exploser le jour de l’ouverture du Parlement, quand le roi, les lords et les représentants seront réunis. L’idée n’est pas seulement de tuer : c’est de provoquer un choc national, puis de rétablir un pouvoir catholique.Pour mettre ce plan en œuvre, les conspirateurs louent un local puis une cave proche du Parlement. Ils parviennent à accumuler 36 barils de poudre. Pour surveiller et déclencher l’explosion, ils recrutent un homme : Guy Fawkes, soldat ayant combattu en Europe, et surtout spécialiste des explosifs.Mais le complot échoue à la dernière minute. Le 26 octobre 1605, une lettre anonyme avertit un lord catholique de ne pas se rendre au Parlement. L’information remonte aux autorités. Dans la nuit du 4 au 5 novembre, les gardes fouillent les sous-sols. Ils trouvent Guy Fawkes avec des allumettes et du matériel pour enflammer la mèche.Fawkes est arrêté, torturé, puis finit par avouer. Les conspirateurs sont traqués. La plupart sont tués ou capturés. Ceux qui survivent sont condamnés à la peine la plus terrible : pendaison, éviscération et démembrement.L’échec du complot a un impact immense : il renforce la méfiance contre les catholiques pendant des générations. Et paradoxalement, Guy Fawkes devient une figure mythique. Chaque 5 novembre, l’Angleterre commémore toujours cet événement : “Remember, remember the Fifth of November…”.
Pourquoi une simple affiche a-t-elle fait trembler un royaume ?
02:23|L’affaire des Placards est l’un de ces événements où une simple feuille de papier déclenche une tempête politique… et change le destin d’un pays. Nous sommes dans la nuit du 17 au 18 octobre 1534, sous le règne de François Ier.Cette nuit-là, des affiches — qu’on appelle alors des “placards” — apparaissent dans plusieurs villes du royaume, notamment à Paris, Orléans, Tours, Rouen, et même Blois. Leur contenu est explosif : ce sont des textes violemment hostiles à la messe catholique, accusée d’être une idolâtrie, et dénonçant ce que les auteurs voient comme une corruption de l’Église.Jusqu’ici, François Ier avait une attitude relativement prudente envers les débuts de la Réforme. Certes, le protestantisme inquiète, mais le roi hésite. Il protège parfois certains humanistes, et reste surtout préoccupé par l’équilibre diplomatique avec le pape et l’empereur Charles Quint.Sauf qu’avec ces placards, on franchit une ligne rouge.Le scandale devient immense quand un de ces textes est placardé jusque sur la porte de la chambre du roi, ou à proximité immédiate de ses appartements. Et là, ce n’est plus une querelle religieuse abstraite : c’est une atteinte directe à l’autorité royale. François Ier y voit une provocation, une insulte, presque une menace.La réaction est brutale. Le roi ordonne une répression exemplaire contre ceux qu’on appelle alors les “luthériens”, même si le mouvement protestant français est plus complexe. Des arrestations ont lieu, des procès sont menés, et plusieurs personnes sont exécutées, notamment par le feu.François Ier organise aussi une grande cérémonie publique : une procession solennelle à Paris, où il affirme sa fidélité à la foi catholique. Autrement dit : il faut montrer à la France, mais aussi à Rome, que le roi ne tolérera pas l’hérésie.Historiquement, l’affaire des Placards marque un tournant : la rupture entre la monarchie et les milieux réformés. Jusque-là, certains espéraient une réforme religieuse “douce”, compatible avec le royaume. Après 1534, la politique change : le protestantisme devient synonyme de danger, d’instabilité, et de défi à l’ordre.C’est aussi un prélude aux conflits à venir : en quelques décennies, la France basculera dans les guerres de Religion. Tout est parti d’affiches, collées en pleine nuit… mais qui ont fait vaciller un royaume.
D'où vient le fameux “tea time” anglais ?
02:04|Le tea time anglais, ou afternoon tea, est aujourd’hui l’un des symboles les plus reconnaissables de la culture britannique. Pourtant, cette tradition si codifiée est née assez tardivement, au début du XIXᵉ siècle, et doit beaucoup à une femme aujourd’hui presque oubliée : Anna Russell.Pour comprendre son origine, il faut d’abord regarder les habitudes alimentaires de l’Angleterre victorienne. À cette époque, les classes aisées ne prenaient que deux repas principaux : un petit-déjeuner relativement léger et un dîner servi très tard, souvent entre 19 et 21 heures. Entre les deux, la journée pouvait sembler interminable, surtout pour les femmes de l’aristocratie, soumises à un emploi du temps rigide fait de visites, de promenades et de réceptions mondaines.Anna Russell, septième duchesse de Bedford et proche de la reine Victoria, se plaint régulièrement d’un malaise très précis : ce qu’elle appelle the sinking feeling, une sensation de faim et de fatigue en milieu d’après-midi. Pour y remédier, elle prend l’habitude de se faire servir, vers 16 heures, une tasse de thé accompagnée de pain, de beurre et de petits gâteaux, dans ses appartements privés. Ce geste, au départ purement pratique, va rapidement prendre une dimension sociale.La duchesse commence en effet à inviter ses amies à la rejoindre pour partager ce moment. Très vite, ce rendez-vous devient une véritable institution mondaine. Le thé n’est plus seulement une boisson, mais un prétexte à la conversation, à l’élégance et à la sociabilité. La pratique se diffuse dans l’aristocratie, puis dans la bourgeoisie, à mesure que le thé devient plus accessible grâce au commerce avec l’Empire britannique.Le teatime s’accompagne alors de règles précises : vaisselle raffinée, pâtisseries délicates, sandwiches au concombre, scones servis avec crème et confiture. Ce rituel incarne parfaitement les valeurs victoriennes : retenue, politesse, maîtrise de soi. Rien n’y est excessif, tout est mesuré, du geste à la parole.Il est important de distinguer l’afternoon tea du high tea, souvent confondus. Contrairement aux idées reçues, le high tea était un repas plus copieux, pris en fin de journée par les classes populaires. L’afternoon tea, lui, est un rite aristocratique, né dans les salons feutrés de l’élite.Ainsi, le teatime anglais n’est pas une tradition ancestrale immuable, mais une invention sociale née d’un simple creux dans l’estomac. Grâce à Anna Russell, un besoin personnel s’est transformé en un rituel emblématique, rappelant que l’Histoire se construit aussi autour de petites habitudes devenues grandes traditions.
Pourquoi le jaïnisme est une religion surprenante ?
02:00|Le jaïnisme est l’une des plus anciennes religions de l’Inde encore pratiquées aujourd’hui. Né il y a près de trois millénaires, il est contemporain, voire légèrement antérieur, au bouddhisme et s’inscrit dans le même vaste mouvement de remise en question du ritualisme védique. Pourtant, le jaïnisme demeure moins connu, alors même qu’il a profondément influencé la pensée religieuse et philosophique indienne.La tradition jaïne reconnaît une lignée de maîtres spirituels appelés Tirthankaras, littéralement « ceux qui ouvrent le gué ». Le plus célèbre d’entre eux est Mahavira, qui aurait vécu au VIᵉ siècle avant notre ère. Il n’est pas considéré comme un dieu, mais comme un être humain parvenu à l’illumination par un ascétisme radical et une parfaite maîtrise de soi. Son enseignement repose sur un principe central : l’ahimsa, la non-violence absolue envers tout être vivant.Dans le jaïnisme, la non-violence n’est pas une métaphore morale, mais une exigence concrète et quotidienne. Tous les êtres, visibles ou invisibles, possèdent une âme. Insectes, plantes, animaux, micro-organismes : tous méritent le même respect. C’est pourquoi le végétarisme y est poussé à l’extrême, excluant parfois même les racines, comme les pommes de terre ou les oignons, dont l’arrachage détruirait des formes de vie souterraines.Cette logique explique aussi certaines pratiques spectaculaires. Certains moines jaïns portent un masque couvrant la bouche, afin d’éviter d’inhaler et de tuer des micro-organismes présents dans l’air. D’autres se déplacent avec un petit balai, souvent en plumes, pour nettoyer le sol avant de s’asseoir ou de marcher, et ainsi ne pas écraser d’insectes. Ces gestes, qui peuvent sembler excessifs, sont en réalité l’expression d’une cohérence philosophique absolue.Le jaïnisme vise un objectif clair : libérer l’âme du cycle des renaissances, appelé samsara. Chaque acte violent, même involontaire, alourdit l’âme et l’éloigne de la libération. À l’inverse, la discipline morale, l’ascèse et la compassion permettent d’atteindre le salut, le moksha.Bien que numériquement minoritaire, le jaïnisme a exercé une influence considérable sur la pensée indienne, notamment sur le bouddhisme, qui reprend l’idée de non-violence, de détachement et de libération par la discipline personnelle. Le jaïnisme rappelle ainsi qu’une religion peut marquer l’Histoire non par la conquête ou le nombre, mais par la radicalité de ses principes.
Pourquoi “le discours perdu de Lincoln” est-il si célèbre ?
02:07|Parmi les discours les plus mystérieux de l’histoire américaine, le “discours perdu” d’Abraham Lincoln occupe une place à part. Aucun enregistrement, aucune transcription complète… et pourtant, il est devenu légendaire. Comment un discours dont on ne possède presque rien a-t-il pu acquérir une telle renommée ?Nous sommes en 1856, à Bloomington, dans l’Illinois. Lincoln, encore loin de la présidence, s’adresse à une convention du tout nouveau Parti républicain. Le sujet est explosif : l’extension de l’esclavage dans les nouveaux territoires américains. Lincoln prend la parole après plusieurs intervenants, sans notes apparentes, et parle pendant près d’une heure. À la fin, la salle est sidérée.C’est là que naît la légende. Les journalistes présents n’écrivent presque rien. Certains racontent avoir posé leurs crayons, incapables de suivre tant le discours était intense. D’autres expliquent qu’ils étaient trop absorbés pour prendre des notes. Résultat : aucun texte officiel n’a survécu. D’où son surnom, le Lost Speech, le discours perdu.Mais l’absence de texte n’a fait qu’amplifier son aura. Les témoignages concordent sur un point : le discours fut exceptionnel. Des auditeurs affirment que Lincoln a atteint ce jour-là une puissance oratoire inégalée, mêlant rigueur logique, colère morale et vision politique. Il n’aurait pas simplement critiqué l’esclavage ; il aurait posé les bases intellectuelles et éthiques de la lutte à venir.Ce discours est devenu célèbre aussi parce qu’il marque un tournant dans la carrière de Lincoln. Après Bloomington, il n’est plus seulement un avocat brillant ou un politicien local. Il devient une figure nationale, reconnue comme l’un des esprits les plus clairs et les plus fermes contre l’esclavage. Deux ans plus tard, ses célèbres débats avec Stephen Douglas confirmeront cette réputation.Le paradoxe est là : ce discours est célèbre précisément parce qu’il est absent. Ne pas pouvoir le lire pousse historiens et citoyens à l’imaginer, à le reconstituer mentalement à partir de fragments et de souvenirs. Il incarne l’idée qu’un moment peut être historiquement décisif sans laisser de trace matérielle directe.Enfin, le “discours perdu” symbolise quelque chose de plus profond : la puissance de la parole politique à l’ère pré-médiatique. Une parole capable de bouleverser une salle entière, de changer des trajectoires politiques, et de marquer l’Histoire… même en disparaissant. Une leçon fascinante sur la mémoire, le mythe et la force des mots.
Pourquoi les samouraïs se noircissaient-ils les dents ?
01:55|À première vue, l’idée peut sembler déroutante, voire inquiétante : pendant des siècles, les samouraïs — et plus largement l’élite japonaise — noircissaient volontairement leurs dents. Cette pratique, appelée ohaguro, n’avait pourtant rien de marginal ou de grotesque. Elle était au contraire profondément ancrée dans les codes esthétiques, sociaux et symboliques du Japon traditionnel.D’abord, il faut comprendre que le noir n’était pas perçu comme une couleur négative. Dans le Japon ancien, le noir évoquait la maturité, la stabilité et la retenue. À l’inverse, des dents blanches étaient souvent associées à l’enfance ou à l’animalité. Se noircir les dents marquait donc le passage à l’âge adulte, en particulier pour les membres de l’aristocratie et les guerriers. Pour un samouraï, arborer des dents noires, c’était afficher sa dignité et son rang.Mais l’ohaguro était aussi un puissant marqueur social. À certaines époques, seuls les nobles, les femmes mariées et les samouraïs de haut rang avaient le droit — ou le devoir — de pratiquer ce rituel. Il signalait la loyauté, notamment dans le cadre du mariage ou du service d’un seigneur. Noircir ses dents revenait à dire : ma position est établie, je n’ai rien à prouver.La pratique avait également une fonction étonnamment pragmatique. Le mélange utilisé pour l’ohaguro — à base de limaille de fer dissoute dans du vinaigre et mêlée à des tanins végétaux — formait une couche protectrice sur l’émail. Résultat : moins de caries, moins d’infections, dans une société qui ne connaissait ni le dentifrice moderne ni la médecine dentaire. D’un point de vue sanitaire, ces dents noires étaient souvent… en meilleure santé que bien des dents blanches européennes de la même époque.Chez les samouraïs, l’ohaguro prenait enfin une dimension morale et guerrière. Le guerrier idéal devait faire preuve de maîtrise de soi, de constance et de fidélité. Le noir, couleur stable et immuable, incarnait ces valeurs mieux que l’éclat trompeur du blanc. Dans une culture où l’apparence reflète l’âme, les dents noires devenaient un prolongement du code d’honneur.La pratique disparaît progressivement à la fin du XIXᵉ siècle, lorsque le Japon s’ouvre à l’Occident et adopte ses normes esthétiques. Aujourd’hui, elle peut surprendre, mais elle rappelle une chose essentielle : les critères de beauté ne sont jamais universels. Ce que nous jugeons étrange était autrefois le symbole même de l’élégance et de la noblesse au Japon, pays à l’histoire et aux codes profondément singuliers.
Pourquoi les Égyptiens dormaient-ils sur des oreillers en pierre ?
01:59|Dans l’Antiquité, les Égyptiens dormaient souvent la tête posée sur un objet qui nous semblerait aujourd’hui totalement inconfortable : un oreiller en pierre, parfois en bois, appelé appui-tête. Pourquoi faire subir un tel supplice à ses cervicales ? La réponse est bien plus raffinée qu’il n’y paraît.D’abord, il faut comprendre que le sommeil, en Égypte ancienne, n’était pas un simple repos, mais un moment chargé de sens symbolique et religieux. Dormir, c’était entrer dans un état intermédiaire entre le monde des vivants et celui des dieux. Or, la tête était considérée comme le siège de l’âme, de l’identité et de la conscience. La surélever pendant la nuit permettait donc de la protéger, physiquement et spirituellement.Ces appuis-tête avaient aussi une fonction très pratique. Le climat chaud de l’ancienne Égypte rendait les nuits étouffantes. En maintenant la tête au-dessus du matelas — souvent une simple natte — on favorisait la circulation de l’air autour du visage et du cou, réduisant la transpiration et l’inconfort. Dormir à plat, la tête collée à une surface chaude, aurait été bien plus pénible qu’on ne l’imagine.Autre avantage essentiel : la protection contre les insectes et les animaux. Scorpions, serpents ou scarabées étaient une menace bien réelle, surtout la nuit. En surélevant la tête, on limitait le risque qu’un animal vienne ramper jusqu’au visage. L’appui-tête devenait ainsi un objet de sécurité domestique.Mais sa dimension la plus fascinante reste symbolique et funéraire. Ces oreillers étaient fréquemment placés dans les tombes, sous la tête des momies. Dans l’au-delà, il s’agissait de garantir que le défunt puisse se relever, respirer et renaître. Certains appuis-tête portaient même des inscriptions protectrices ou des représentations de dieux chargés d’éloigner les forces du chaos pendant le sommeil éternel.Enfin, il faut oublier notre idée moderne du confort. Les Égyptiens n’associaient pas le bien-être à la mollesse, mais à l’ordre, à la stabilité et à la protection. Un objet dur, solide, éternel comme la pierre, incarnait ces valeurs bien mieux qu’un coussin moelleux.Ainsi, loin d’être une bizarrerie, l’oreiller en pierre révèle une civilisation où le corps, le sommeil et l’au-delà étaient intimement liés. Une leçon qui rappelle que le confort est aussi… une construction culturelle.
Où les tunnels secrets de Léonard de Vinci ont-ils été découverts ?
02:22|Pendant plus de cinq siècles, ils n’étaient qu’une hypothèse, un détail mystérieux dans des carnets griffonnés à l’envers. Aujourd’hui, des chercheurs italiens viennent de confirmer leur existence : des tunnels souterrains conçus par Léonard de Vinci ont bien été découverts sous le château des Sforza, à Milan.Le Castello Sforzesco est l’un des symboles les plus imposants de la Renaissance italienne. Construit au XVe siècle par la puissante famille Sforza, il servait à la fois de résidence, de forteresse et de centre de pouvoir militaire. C’est précisément dans ce contexte que Léonard de Vinci arrive à Milan, vers 1482, au service du duc Ludovic le More. L’artiste n’est alors pas seulement peintre : il est aussi ingénieur militaire, architecte et stratège.Dans ses célèbres carnets, Léonard dessine des plans complexes de fortifications, de bastions… et de galeries souterraines. Longtemps, les historiens ont cru qu’il s’agissait de projets théoriques, voire de simples exercices intellectuels. Mais les technologies modernes ont changé la donne.En 2024, une équipe de chercheurs italiens a utilisé des techniques de radar à pénétration de sol, de scans laser et de modélisation 3D pour explorer les fondations du château. Les résultats sont sans appel : plusieurs galeries étroites et voûtées, situées à plusieurs mètres sous terre, correspondent précisément aux schémas de Léonard de Vinci. Certaines relient différentes parties du château, d’autres semblent mener vers l’extérieur des remparts.À quoi servaient ces tunnels ? Les hypothèses convergent vers un usage militaire et stratégique. Ces passages permettaient de déplacer des soldats discrètement, de ravitailler la forteresse en cas de siège, ou encore d’offrir une voie de fuite aux dirigeants. L’une des galeries pourrait même avoir été conçue pour permettre au duc de rejoindre rapidement les troupes stationnées à l’extérieur du château.Ce qui rend cette découverte fascinante, c’est la précision de Léonard de Vinci. Ses dessins, vieux de plus de 500 ans, se révèlent d’une exactitude remarquable, tant dans les proportions que dans l’orientation des structures. Ils confirment que Léonard ne se contentait pas d’imaginer : il concevait des ouvrages destinés à être construits et utilisés.Aujourd’hui encore, une grande partie de ces tunnels reste inaccessible au public, pour des raisons de sécurité et de conservation. Mais leur validation scientifique éclaire d’un jour nouveau le génie de Léonard de Vinci et rappelle que la Renaissance ne s’est pas seulement jouée sur les murs des palais, mais aussi sous terre, dans l’ombre des stratégies et de l’ingénierie.Une preuve de plus que, cinq siècles plus tard, Léonard de Vinci continue de révéler ses secrets.
Pourquoi des scientifiques ont-ils préféré mourir de faim plutôt que de manger des graines ?
02:25|Pendant le siège de Leningrad, l’un des plus longs et des plus meurtriers de la Seconde Guerre mondiale, une poignée de scientifiques a accompli un acte de courage presque inimaginable. Alors que la ville était encerclée par les troupes allemandes, coupée de ses ravitaillements et plongée dans une famine extrême, des chercheurs de l’Institut Vavilov ont fait un choix radical : protéger à tout prix une collection de graines, quitte à en mourir.Fondé par le généticien Nikolaï Vavilov, l’institut était à l’époque l’une des plus grandes banques de semences du monde. On y conservait des variétés rares de céréales, de légumineuses, de tubercules et de plantes alimentaires venues des quatre coins du globe. Ces graines n’étaient pas de simples échantillons : elles représentaient des décennies de recherche et, surtout, une réserve génétique essentielle pour l’avenir de l’agriculture mondiale.Lorsque le siège commence en 1941, la situation devient rapidement désespérée. Les rations diminuent, l’hiver est glacial, et la faim tue des centaines de milliers de civils. À l’intérieur de l’institut, les chercheurs vivent entourés de sacs de riz, de blé, de pommes de terre séchées ou de graines oléagineuses. De quoi survivre, au moins temporairement. Pourtant, ils n’y touchent pas.Pour ces scientifiques, consommer la collection aurait été une trahison de leur mission. Ils savaient que ces graines pourraient un jour sauver des populations entières de la famine, bien au-delà de Leningrad et de la guerre. Les manger aurait signifié anéantir un patrimoine irremplaçable, fruit de voyages, d’expéditions et de sacrifices humains considérables.Malgré la faim, le froid, les bombardements et la menace constante des pillages, ils organisent la protection de la collection. Ils déplacent des échantillons, les dissimulent, les surveillent jour et nuit. Certains meurent assis à leur bureau, affaiblis par la malnutrition, entourés de graines intactes. Sur les douze scientifiques restés sur place pendant les pires mois du siège, seuls trois survivent.Leur sacrifice n’a pas été vain. La collection de l’Institut Vavilov a traversé la guerre et existe encore aujourd’hui. Elle contient des centaines de milliers de variétés végétales, dont certaines ont disparu à l’état naturel. Grâce à elles, des chercheurs modernes travaillent sur la résistance aux maladies, au changement climatique et aux famines futures.Cet épisode rappelle que, même au cœur de la barbarie et du désespoir, certains ont choisi de penser à l’humanité de demain. En protégeant ces graines au prix de leur vie, ces scientifiques ont semé bien plus que des plantes : ils ont laissé un héritage moral et scientifique unique dans l’histoire.